RECHERCHES VENDÉENNES n°4 (1997)
I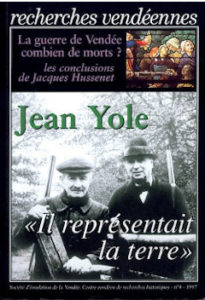 l représentait plus que sa province, plus encore qu’un pays, si grand que soit ce pays paysan : il représentait la terre. » Ainsi Henri Pourrat, l’inoubliable auteur de Gaspard des Montagnes, revoit-il Jean Yole en Bourgogne, un certain jour de 1936, buvant le chambertin de Gaston Roupnel en compagnie des écrivains de la terre. Jean Yole (1878-1956) représentait la terre : et pourtant, qui aujourd’hui a lu le grand écrivain vendéen ? Jean Yole fut-il le témoin nostalgique – réactionnaire, admettra-t-il par provocation – d’une ruralité en voie de disparition accélérée ? Ou le prophète d’un monde qui n’idolâtrerait plus le progrès matériel ? Le moment semble venu de tenter un inventaire.
l représentait plus que sa province, plus encore qu’un pays, si grand que soit ce pays paysan : il représentait la terre. » Ainsi Henri Pourrat, l’inoubliable auteur de Gaspard des Montagnes, revoit-il Jean Yole en Bourgogne, un certain jour de 1936, buvant le chambertin de Gaston Roupnel en compagnie des écrivains de la terre. Jean Yole (1878-1956) représentait la terre : et pourtant, qui aujourd’hui a lu le grand écrivain vendéen ? Jean Yole fut-il le témoin nostalgique – réactionnaire, admettra-t-il par provocation – d’une ruralité en voie de disparition accélérée ? Ou le prophète d’un monde qui n’idolâtrerait plus le progrès matériel ? Le moment semble venu de tenter un inventaire.
Dans le présent numéro de Recherches vendéennes, on trouvera également les conclusions, particulièrement attendues, de Jacques Hussenet sur le nombre des morts pendant la guerre de Vendée, ainsi que de nombreux autres articles qui prouvent la vitalité de la recherche historique en Vendée.
Alain GÉRARD & Thierry HECKMANN, Éditorial : « Il représentait la terre », p. 7-9.
Dossier : Jean Yole. « il représentait la terre » (p. 11-94)
« Il représentait plus que sa province, par Henri Pourrat », p. 13-14.
« Le lieu, notre maître et notre ami, par Jean Yole », p. 15-38.
Jean HUGUET, « À la rencontre de Jean Yole », p. 39-52.
Christiane ASTOUL-CALENDREAU, « Jean Yole, le romancier », p. 53-90.
« Malaise paysan, malaise de la mémoire, par Jean Rivière », p. 91-92.
« La vie et l’oeuvre de Jean Yole », p. 93-94.
Dossier : La guerre de Vendée : combien de morts ? (p. 95-218)
Alain GÉRARD, « La démographie vendéenne : un nouveau chantier », p. 97-100.
Pierre ARCHES, « Guerre de Vendée et sources démographiques pendant la Révolution et
l’Empire. Essai critique sur les Deux-Sèvres », p. 101-146.
Jacques HUSSENET, « La guerre de Vendée : combien de morts ? Le bilan des Deux-Sèvres », p. 147-162.
Jacques HUSSENET, « La guerre de Vendée : combien de morts ? Bilan, réflexions et
perspectives », p. 163-218.
Études (p. 219-430)
Isabelle FERCHAUD, « À Montournais à la fin du Moyen Âge, la seigneurie de la Maison
Neuve », p. 221-234.
Élisabeth BOUSSEAU, « La réalité de l’unité religieuse du bocage vendéen au XVIIIe siècle : l’exemple des cantons de Mortagne-sur-Sèvre et de Montaigu », p. 235-268.
Blandine BUET, « Le Conseil supérieur de Châtillon et l’organisation civile du soulèvement vendéen », p. 269-303.
Pierre MARAMBAUD, « Lequinio : la Vendée et le rejet de la Terreur », p. 305-329.
Roger LÉVÊQUE, « Le droit de passe en Vendée », p. 331-349.
Bertrand BARBEAU, « La répression politique en Vendée au début de la seconde Restauration, 1815-1818 », p. 351-387.
Pierre-Yannick LEGAL, « Formalisme des marchés et liberté créatrice, la pratique d’un facteur d’orgues, Louis Debierre », p. 389-430.
Alain GÉRARD, « François Furet, le mélancolique », p. 431-440.
Comment se procurer nos publications ?
Rendez-vous sur la page « notre librairie »